Great
Quand l’identité devient une faute politique : le cas de Maurice Kamto.
- Accueil
- Quand l’identité devient une faute politique : le cas de Maurice Kamto.
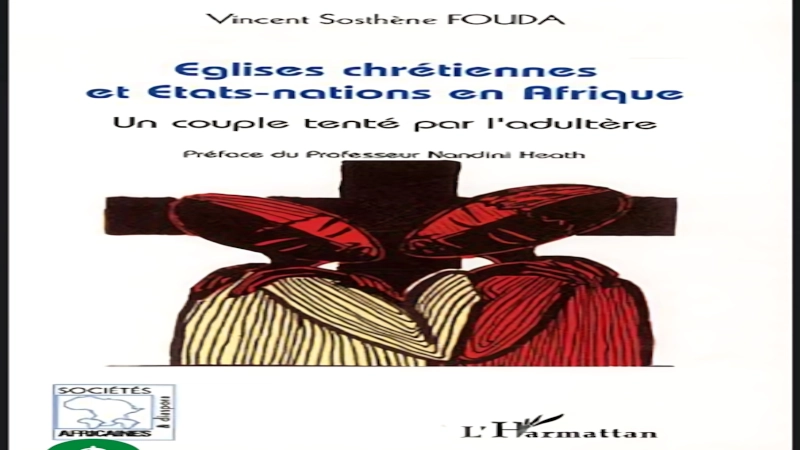
Quand l’identité devient une faute politique : le cas de Maurice Kamto.
« Je m’appelle KAMTO Maurice, je suis né le 15 février 1954 à Bafoussam. Ô Bafoussam! Bafoussam indique un lieu géographique au Cameroun. Suivant notre nomenclature ethnique au Cameroun, je suis Bamiléké. […] Certains auraient voulu que je vienne ici m’excuser de mes origines ethniques. Que non ! Parce que je pose depuis plusieurs années dans ce pays : “Qui d’entre nous a choisi de naître là où il est né ?” Il m’est arrivé durant la campagne de dire : “Dites-le. Dites-moi au Sud. Si pour être Bulu il faut passer un concours, dites-moi quel concours alors, je veux le passer pour devenir moi aussi Bulu.” »
1. Une affirmation identitaire dans un contexte inflammable
Dans un pays comme le Cameroun, où les tensions ethniques sont latentes, l’affirmation publique d’une identité comme « Je suis Bamiléké » ne peut être perçue comme anodine. Elle agit comme un détonateur symbolique, réveillant des mémoires collectives douloureuses, des rivalités historiques et des peurs de domination.
Ce n’est pas tant l’identité en elle-même qui est problématique, mais le contexte dans lequel elle est affirmée.
2. Une faute politique lourde : l’identité affirmée dans l’arène institutionnelle
Un acte réfléchi et délibéré
Lorsque Maurice Kamto affirme « Je suis Bamiléké » devant le Conseil Constitutionnel, il ne s’adresse pas seulement aux juges constitutionnels, mais à toute la nation camerounaise. Ce n’est pas une confidence personnelle, une déclaration de bout de table lors d’un dîner entre copains ou en famille! C’est une déclaration de préambule mais une déclaration publique, solennelle, et politique.
Kamto ne fait pas qu’informer. Il pose un cadre, oriente la lecture de tout ce qui va suivre. Il dit, en substance : « Je suis ce que je suis, et je ne m’en excuse pas. »
Ce préambule devient ainsi :
Une affirmation de dignité personnelle. Une réponse anticipée aux accusations de communautarisme. Une mise en tension entre l’identité et la citoyenneté. La citoyenneté comme abstraction égalitaire
La déclaration de KAMTO Maurice vise un but bien précis, celui de dissoudre la citoyenneté camerounaise dans son appartenance ethnique à lui, en faisant abstraction de tout ce qui fonde la République et la citoyenneté qui va avec à savoir : une égalité abstraite, détachée des appartenances sociales ou communautaires. Le citoyen est conçu en République comme un individu universel, membre d’un « grand tout national » comme nous l’enseignait Pierre Rosanvallon.
Cette conception vise à neutraliser les identités particulières (ethniques, religieuses, sociales) pour construire une unité politique et c’est le rôle comme la mission de la politique, du politique et de toute politique, KAMTO ne saurait l’ignorer.
Il sait que ses mots seront analysés, repris, commentés. Il en mesure les conséquences dans un pays où l’ethnicité est un sujet inflammable.
Un moment de vérité symbolique
Devant le Conseil Constitutionnel, Kamto ne se contente pas de défendre un dossier électoral. Il se met en scène comme un homme, né le 15 février 1954 à Bafoussam, il ferme les yeux puis il dit ô Bafoussam! Avant de poursuivre, « Je suis Bamiléké », il n’est plus alors que le fils du Grassfield rien que cela et rien d’autre puisque dans la suite il demande à passer le concours pour être Bulu. Il met face à face les deux communautés tout en sachant que si le concours lui était proposé il ne le passerait pas. Tout est dans son gestuel alors, il vit son appartenance à la communauté Bamiléké comme une consécration.
Ce qui est juste, qui ne serait pas fier de sa communauté ancestrale! En affirmant « Je suis Bamiléké », il semble franchir une ligne intérieure : celle de l’auto-révélation, celle de son exclusion de la Communauté nationale
Ce n’est plus seulement le juriste ou le politicien qui parle, mais l’homme enraciné dans une histoire, une mémoire, une identité.
3. Vers une sortie de crise ?
Si l’affirmation identitaire devient un acte radical, cela signifie que le pays a besoin.
PRIMO : D’un nouveau contrat social, où toutes les identités peuvent s’exprimer sans crainte. Le Cameroun a aujourd’hui un besoin urgent d’un nouveau contrat social, fondé sur la reconnaissance et la valorisation de toutes les identités qui composent la nation. Dans un contexte où l’ethnicité est souvent instrumentalisée à des fins politiques, il devient impératif de construire un cadre institutionnel et symbolique où chaque citoyen peut exprimer son appartenance culturelle sans crainte d’exclusion ou de stigmatisation. Ce contrat social ne doit pas effacer les différences, mais les intégrer dans une vision commune de la citoyenneté, où l’unité ne se fait pas au prix de l’uniformité. Il s’agit de passer d’une démocratie de façade à une démocratie de reconnaissance, où l’État garantit à chacun non seulement des droits égaux, mais aussi une égale dignité dans la diversité. C’est à cette condition que le vivre-ensemble pourra se reconstruire sur des bases solides, durables et véritablement inclusives.
SECUNDO : D’un leadership courageux, capable de dépasser les clivages ethniques sans les nier. Le Cameroun a également besoin d’un leadership courageux, capable de dépasser les clivages ethniques sans pour autant les nier. Dans une société marquée par une histoire de divisions communautaires, le rôle du leader ne peut plus se limiter à incarner une ethnie ou à rassurer un camp. Il doit au contraire porter une vision inclusive, capable de reconnaître les blessures du passé, tout en proposant un avenir commun. Ce courage politique consiste à affronter les vérités, à nommer les fractures, mais aussi à refuser leur instrumentalisation. Un tel leadership ne cherche pas à effacer les identités, mais à les articuler dans un projet national partagé, où chaque citoyen se sent représenté, respecté et engagé. C’est dans cette capacité à conjuguer lucidité historique et ambition collective que se joue la refondation du lien civique.
TERTIO : D’un espace médiatique responsable, qui ne transforme pas chaque mot en arme politique. Le Cameroun a enfin besoin d’un espace médiatique responsable, capable de jouer son rôle de quatrième pouvoir sans devenir un amplificateur de divisions. Trop souvent, les médias — qu’ils soient traditionnels ou numériques — transforment chaque mot prononcé par une figure publique en arme politique, exacerbant les tensions au lieu de les apaiser. Dans un contexte où les sensibilités identitaires sont vives, cette dérive est particulièrement dangereuse. Un journalisme éthique et rigoureux devrait au contraire favoriser la nuance, contextualiser les propos, et ouvrir des espaces de dialogue, plutôt que de nourrir la polarisation. Il ne s’agit pas de censurer les débats, mais de les élever, en refusant la logique du buzz et de la manipulation émotionnelle. Un tel espace médiatique est essentiel pour reconstruire la confiance entre les citoyens et leurs institutions.
Pour conclure, revenons à une règle de base de la rhétorique qui est que ce que l’on énonce c’est ce qui ne va pas de soi, ce qu’on ressent le besoin de préciser. Alors pourquoi KAMTO Maurice éprouve le besoin de dire ici devant le Conseil Constitutionnel qu’il est BAMILEKÉ? Il pose les bases de ce que nous vivons actuellement dans l’espace public 7 ans après ce préambule. La Grande fracture entre la communauté des Zélateurs et le reste du Cameroun. Alors oui KAMTO par sa déclaration nous dit qu’il existe au Cameroun une bamiphobie systémique.
ATN
Recent Posts
- Paul Atanga NJI — Le Ministre que tout gouvernement souhaiterait avoir.
- Bravo CAMWATER, l’eau de nouveau disponible à Douala : Le piège a été évité, Douala fêtera avec CAMWATER.
- COMMUNIQUÉ : RETOUR PROGRESSIF À LA NORMALE DE LA PRODUCTION D’EAU POTABLE À L’USINE DE YATO.
- Origine des noms de 10 quartiers de Douala.
- La Presse au Rendez-vous du Dimanche 21 décembre 2025 sur Tchad24 international.
- Des étoiles et des médailles ! Paul BIYA prime le professionnalisme, la loyauté et les efforts de promotion du Cameroun à l’international.
- La solution finale à la crise en cours dans les régions Anglophones de la République du Cameroun par Dr. Success NKONGHO.
- La finale de la Coupe du Cameroun a lieu ce dimanche 14 décembre 2025 au stade Ahmadou Ahidjo.
- LES 20 QUESTIONS LES PLUS IMPORTANTES SUR LA CRISE ANGLOPHONE QUE LE GOUVERNEMENT CAMEROUNAIS REFUSE DE RÉPONDRE DEPUIS 9 ANS.
- La CAF et le LOC dévoilent « Assad », la Mascotte Officielle de la TotalEnergies CAF Couple d’Afrique des Nations, Maroc 2025.
- 🔵 COMMENT COMPRENDRE LES 101 COUPS DE CANON QUI SERONT TIRÉS CE JOUR À YAOUNDÉ ?
- Les dattes, un joyau énergétique naturel.
- « Ne sortez pas, restez chez vous. Chers parents retenez vos enfants à la maison, s’ils sortent, ils risquent de se faire tuer. » : Ce qu’ils nous ont dit.
- 🇨🇦🇨🇲 Le Haut commissariat du Canada au Cameroun préoccupé par les violences survenues après la proclamation des résultats de l’élection présidentielle dont il prend acte.
- Sécurité : Douala revit, constat fait par le Gouverneur du Littoral, Samuel Dieudonné IVAHA DIBOUA cette matinée.
- 🇨🇲 Cameroun — Présidentielle 2025 : l’Union Européenne valide le scrutin et appelle à l’unité.
Recent Comments


Felicitation Stephy, les annees de travail dur sans fatigue paie deja.

J'ai finalement le sentiment que l'agrégation de kamto est un bricole

Hallo !

Nobis eum reiciendis hic.
